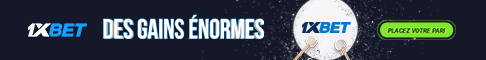Dans un vote crucial qui cristallisait les espoirs de la gauche et les craintes du patronat, l’Assemblée nationale a rejeté ce 31 octobre 2025 la taxe Zucman sur les très hauts patrimoines, ainsi que sa version allégée. Ce rejet sonne comme un grave échec pour la NUPES et une victoire pour le gouvernement Lecornu et la droite, ravivant les tensions politiques sur la justice fiscale.
Les députés ont largement rejeté les amendements de la gauche qui proposaient d’instaurer un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines nets excédant 100 millions d’euros. Une version négociée, dite « taxe Zucman light », proposant un taux de 3 % à partir de 10 millions d’euros mais exemptant les entreprises innovantes et familiales, a subi le même sort. Le scrutin a été sans appel : 172 voix pour, 228 contre.
Portée par les travaux de l’économiste Gabriel Zucman, cette taxe fonctionnait comme un impôt plancher. Son objectif était de corriger une inégalité fiscale : les ultra-riches, qui paient proportionnellement moins d’impôts que la classe moyenne, auraient dû s’acquitter d’un prélèvement minimal représentant 2 % de leur fortune. Environ 1 800 foyers français étaient concernés.
Le rejet de ce vendredi couronne une intense bataille qui a transcendé le seul cadre parlementaire. Entre août et septembre, plus de 486 000 publications sur les réseaux sociaux ont évoqué la taxe, relayées par 86 000 internautes. Le débat, extrêmement polarisé, a structuré un clivage politique inédit, avec une opinion publique majoritairement favorable : 74 % des Français soutenaient la mesure, selon un sondage Elabe.
Face à une gauche unie dans sa défense du projet, l’opposition fut tout aussi déterminée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a exprimé son « profond désaccord », estimant qu’il n’existait pas « d’impôt miracle » et jugeant le dispositif inconstitutionnel. Laurent Wauquiez, chef des députés LR, a fustigé une « folie fiscale » qui, selon lui, « aurait juste tué l’emploi et l’activité économique ».
Ce rejet marque un tournant dans le débat budgétaire. La gauche, et particulièrement le Parti socialiste, perdait son principal levier de négociation. Certains socialistes laissaient planer la menace d’une censure si le gouvernement ne faisait pas de concessions sur la fiscalité des plus riches. Le gouvernement, quant à lui, évite pour l’instant un grave crise politique.
Au-delà de l’épisode parlementaire, le rejet de la taxe Zucman consacre la force d’un symbole. Elle était devenue bien plus qu’une simple mesure technique : un marqueur de justice fiscale, un objet de société, et sans doute, une ligne de fracture qui structurera les batailles politiques à venir.
Bah Mohamed